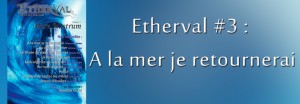Du 1er novembre au 1er décembre, c’est le mois consacré à la promotion des auteurs francophones de SF, fantasy et fantastique, à l’initiative de l’invasion des grenouilles !
Aujourd’hui, je vous parlerai d’Etherval, magazine consacré aux littératures de l’imaginaire. Etherval a publié 5 de mes nouvelles (et en a accepté 6e !). Les nouvelles sont disponibles à cette adresse : en version papier, ou numérique (où vous pouvez acheter les nouvelles à la pièce). Certaines existent en version audio.
C’est le cas de « A la mer je retournerai », nouvelle publiée dans le numéro « Mare Nostrum ».
Un petit extrait
Jour 1
Je ne sais pas quel jour nous sommes et, honnêtement, je m’en fiche pas mal. Il n’y a plus de calendrier depuis des années. À quoi bon franchement ? Je fixe arbitrairement la date d’aujourd’hui à « jour 1 ».
J’ai trouvé ce cahier, ainsi qu’un stock de crayons gris, dans une école en ruines de la ville où nous venons d’arriver. Un coup de chance, voilà des lustres qu’on n’en fabrique plus. Depuis que la civilisation s’est écroulée en fait.
J’essaye de ne pas trop réfléchir à tout cela, tout comme je cherche à ne pas trop penser à Anna. C’est une fille du groupe avec qui je vis. On doit avoir à peu près le même âge, soit approximativement une quinzaine d’années. Si nous étions nées et avions grandi avant l’apocalypse, Anna aurait été ma meilleure amie, vu qu’on réalise tout ensemble : pêcher, ramasser des coquillages, réparer les filets. Ou plutôt, on accomplissait tout ensemble jusqu’à ce matin.
Cela faisait des jours qu’on marchait depuis le nord, en longeant les plages et les dunes. Nous avions finalement découvert cette ville, au détour d’un repli de la côte. Elle était désertée depuis un moment déjà. Les habitants s’étaient enfuis ou avaient péri, les trois quarts des bâtiments tombaient en ruine. Mais bon, nous n’allions pas nous montrer difficiles et au moins, nous nous trouvions en bord de mer. Et puis, tout le monde en avait assez de marcher sans savoir où aller.
Mon oncle Jean, le chef de notre groupe, a ordonné l’arrêt. Tout le monde s’est éparpillé dans les rues. Nous voyageons depuis tellement longtemps que nous savons tous quelles tâches nous devons accomplir. Moi, je n’ai d’ailleurs connu que cette vie : marcher au bord de l’océan, sans jamais s’enfoncer dans les terres, s’abriter dans une ville côtière un moment, puis repartir.
Dans la tribu, Anna et moi restons les plus jeunes et nous sommes chargées d’aller sur la rive pour trouver de quoi manger. Coquillages et crustacés, comme le chantait ma mère. Tout avait bien commencé. Anna était ravie qu’après plusieurs jours de marche, on ait enfin trouvé un endroit où nous installer. Elle espérait que, cette fois-ci, on s’ancrerait dans cette ville, au moins le temps de l’hiver, et pourquoi pas plus longtemps. Elle semblait joyeuse. De nous deux, elle était toujours la plus gaie, une jolie blonde aux yeux bleus. Moi, je suis plutôt la copine moche avec mes cheveux marron filasses, qui ressemblent à des algues, ma peau huileuse comme le dos d’une anguille et grisâtre comme le ventre d’un poisson.
Anna ne s’était jamais laissée abattre par la vie que nous menions. Elle trouvait perpétuellement une raison de ne pas désespérer. Aujourd’hui, elle paraissait heureuse que nous ayons atteint un nouveau foyer. Retirant ses chaussures, elle est entrée dans l’océan en chantant. Elle a ri en sautant dans les vagues. Je suis restée sur le bord : je n’aime pas l’eau, la mer m’effraie.
Cela doit être pour cette raison que je suis encore en vie et elle non. Les Profonds sont sortis brusquement des flots. De loin, ils peuvent sembler humains, mais il n’en est rien. Ce sont des monstres et nous sommes leur nourriture préférée. Ils ont surgi et l’ont attrapée. Elle a hurlé, moi aussi. Elle s’est débattue et a essayé de se libérer. Cependant, cela ne sert à rien quand un Profond vous capture. Leurs membres flasques et visqueux se révèlent bien plus forts qu’il n’y paraît. Leurs mains palmées vous agrippent et vous entraînent vers les profondeurs. J’ai ramassé des galets sur la plage que je leur ai lancés, sans cesser de crier. L’un de mes projectiles en a touché un à la tête. Il s’est tourné vers moi et m’a regardée avec ses yeux de poisson. Je me suis figée, glacée par la terreur. Ils ont ceinturé Anna et ont plongé. L’eau a noyé ses derniers cris.
Je suis restée seule sur le rivage. Des larmes ont commencé à couler le long de mes joues. Mes jambes se sont dérobées sous moi et je suis tombée, à genoux dans le sable. Mon oncle Jean m’a découverte là, des heures plus tard. Il m’a murmuré quelques paroles bourrues et m’a ramenée vers la ville, vers l’abri que le groupe avait aménagé dans cette vieille école. Après le repas, je suis allée explorer le bâtiment pour me changer les idées. Aux murs des classes se trouvaient encore des dessins d’enfants, jaunis par le temps. Leurs gribouillis de mers bleues et de plages sous le soleil m’ont mise étrangement mal à l’aise. Je me suis installée pour dormir dans une petite pièce, une réserve apparemment. J’y ai déniché ce cahier et les crayons. Je les ai pris, parce qu’il fallait que j’écrive.
Je n’ai jamais compris les événements quand je les vis. Tandis que lorsque quelques mots sommaires sont couchés sur le papier, soudainement tout s’éclaire.
*
Jour 4
Aujourd’hui, je me suis encore réveillée trempée de sueur. J’ai fait un cauchemar. Ou un « cauchemer », comme je les appelle. Année après année, ce rêve reste le même, avec quelques variantes. Je rêve de la mer. Pas celle qu’on voit danser le long des golfes clairs, non. L’océan aux eaux mouvantes et traîtresses. Cette chose liquide qui vous happe pour mieux vous noyer. Cette étendue que je déteste la plupart du temps mais qui, certains jours, quand les rayons du soleil deviennent rasants, me fascine étrangement.
Je me suis levée et suis descendue dans l’ancien préau de l’école. Mon oncle Jean se tenait là et m’a demandé de l’accompagner pour pêcher au large. Je n’aime pas me trouver loin du rivage, mais je ne peux désobéir à mon oncle. À la mort de ma mère, il m’a prise sous son aile. Il m’a élevée, appris à lire et à écrire, enseigné tout ce qu’il savait. Je lui dois la vie et il reste la seule personne à qui je puisse accorder ma confiance. Je n’ignore pas que sans lui, les autres membres du groupe m’auraient sûrement chassée, ou peut-être tuée. Il parait que sous une certaine lumière, je ressemble assez à un Profond.
Bastien et Katia nous attendaient dehors, une machette passée à la ceinture, en cas de mauvaise rencontre. Ils n’ont pas eu l’air enchantés de me voir, néanmoins, ils n’ont pas mis en cause la décision de Jean. Je ne suis pas la seule à lui devoir la vie.
Nous avons trouvé, sur la berge, une vieille barque que nous avons retapée. Emeline, la doyenne du groupe, avait déjà rafistolé des filets rejetés par la marée. Nous nous sommes embarqués alors que l’aube pointait.
Je n’apprécie pas la mer, je déteste la pêche et les poissons me répugnent. Mais qui aime tout ça, quand on sait ce qui se balade sous nos pieds ? Le visage hurlant d’Anna danse encore devant mes yeux lorsque je ferme les paupières. Le risque d’être attaqués par les Profonds lors d’une sortie au large demeure important, néanmoins, nous devons manger. Alors, dans notre petite communauté, comme pour les tours de garde, il y a des tours de pêche.
Jean et Bastien ont pris les rames, alors que Katia et moi nous occupions des filets. On s’est éloignés de la côte. Pas de beaucoup, vu que personne n’a envie de perdre la terre de vue. Au fur et à mesure qu’on progressait, ma nausée augmentait. Le mal de mer, en somme.
On a lancé les nasses et on a attendu. Soudain, Katia a poussé un cri et a pointé un bouillonnement, à quelques brasses. Les Profonds en ont émergé à côté de nous. Nous nous sommes tous figés. Ils nous ont observés, yeux de poisson dans une face humanoïde, puis ont replongé. La pêche a été bonne après ça, même si personne n’a voulu se réjouir avant qu’on ait regagné la terre ferme.
En posant le pied sur le sable, je me suis aperçue que je tremblais de tous mes membres. J’ai réprimé le haut-le-cœur qui montait et me suis éloignée en titubant. J’ai regardé vers l’intérieur des terres. Elles étaient, comme toujours, enveloppées dans une sorte de brouillard jaunâtre, totalement impénétrable. Je savais ces miasmes toxiques. Quelques respirations signifiaient une mort certaine. J’ai jeté un coup d’œil par-dessus mon épaule, vers cette saleté liquide. Les seules parcelles habitables restent les littoraux. J’ai serré les poings en pensant aux horreurs qui dorment au fond de ces eaux noires, n’attendant qu’un seul faux pas de notre part pour nous anéantir. Jean a posé la main sur mon épaule, me faisant sursauter.
– Allez viens, Marie, on rentre.
Je déteste quand il agit comme ça. Je hais mon prénom, depuis qu’on m’a révélé qu’il signifiait « mer », dans une ancienne langue. Et plus que tout, j’éprouve une haine primaire envers l’océan.