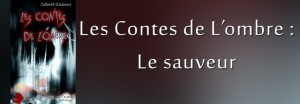Du 1er novembre au 1er décembre, c’est le mois consacré à la promotion des auteurs francophones de SF, fantasy et fantastique, à l’initiative de l’invasion des grenouilles !
Aujourd’hui, coup de projecteur sur Lune Ecarlate, jeune maison d’édition (un peu plus d’un an, il me semble), qui a publié une de mes nouvelles : Le sauveur, dans l’anthologie « contes de l’ombre » et qui s’apprête à en publier une deuxième : légendes brisées, dans l’anthologie « monstres à vapeur ». (précommandes ici, avec en bonus une carte dédicacée de ma douce main et de mon écriture gracieuse).
Si vous aimez le fantastique tendance XIXe, vous devriez apprécier les contes de l’ombre. Disponibles en numérique et papier sur le site de l’éditeur, et en numérique chez Amazon, Fnac, Emaginaire et Immatériel.
Un petit extrait :
Ils disent que j’ai perdu la tête, mais ils ont tort. Je ne me suis jamais senti aussi lucide qu’en ces jours. Mes nerfs sont d’acier, ma raison n’a pas vacillé malgré tout ce que j’ai vécu. Grâce à ma force de caractère, j’ai pu sauver mon meilleur ami des griffes de Ceux du Dehors.
Rien ne nous prédisposait, Louis et moi, à devenir si proches. Louis Pierron représentait pour moi la parfaite essence du Français, dont nous autres Américains aimons nous gausser, avec toutefois une pointe de jalousie.
Il se montrait de tempérament enjoué. Grand, athlétique, un visage rieur et un esprit affûté, il savait plaire aux femmes et gagner le respect des hommes en quelques phrases. Il prisait les vins raffinés, la nourriture de qualité et les vêtements à la mode. Il semblait rayonner en permanence.
Comparé à lui, je paraissais fade, Américain craintif fraîchement débarqué de New York, perdu dans le dédale des rues et des fêtes parisiennes. Je m’habillais mal, je l’avoue, toujours de couleur terne. Je parlais peu, non parce que mon français laissait à désirer, mais par pure timidité. Louis disait que, malgré mes vingt ans, j’avais les manières d’un vieux garçon de cinquante ans passés.
Nous fréquentions tous les deux les Beaux-Arts de Paris. Le hasard avait voulu que nous logions dans une pension de la rue des Champs, dans les arrières de Montmartre. La propriétaire, la veuve Grégoire, comme tous l’appelaient, louait pour un prix tout à fait raisonnable des chambres aux étudiants. J’habitais au dernier étage, juste sous les toits, Louis occupait l’appartement en dessous du mien.
Bien que je ne lui ressemble guère, ou peut-être parce que nos différences l’amusaient ou qu’il plaignait ce pauvre Américain esseulé à Paris, Louis m’avait rapidement pris en affection. Nous passions le plus clair de notre temps ensemble, nous nous rendions tous deux à l’Académie et nous partagions un atelier dans une des rues voisines de notre foyer.
En cette fin de XIXe siècle, tous clamaient que la photographie représentait l’avenir, mais ni Louis ni moi ne les croyions. Nous souhaitions tous les deux devenir portraitistes, apprendre à saisir l’essence d’une personne en quelques coups de pinceau.
J’étais un artiste honnête ; je pouvais peindre un portrait réaliste de n’importe qui, je maîtrisais les expressions du visage et bénéficiait d’un goût relativement sûr en matière de couleur. Louis, au contraire, se montrait plus irrégulier. Un jour, ses toiles étaient tout juste bonnes à brûler dans l’âtre d’une cheminée, le lendemain, elles auraient mérité de figurer dans un musée. J’admirais mon compagnon pour ces fulgurances, en retour il enviait ma constance.
— Griffin, me disait-il, si je possédais la moitié de ton talent, j’aurais déjà fait fortune auprès de la haute société.
L’Art occupait toutes nos journées, mais le soir venu, en compagnie d’autres condisciples, nous écumions les cafés, cabarets et troquets de Paris.
Louis aimait chanter, danser, papillonner et séduire. Il évoluait dans son élément. Pour moi, ces nuits dégageaient quelque chose d’irréel et d’étourdissant, mais je suivais mon ami où qu’il aille. Louis collectionnait les conquêtes, je l’ai vu parader au bras de créatures splendides. Blondes, brunes ou rousses, peu lui importait, pourvu qu’elles soient avenantes et montrent de l’esprit. Il prisait particulièrement les beautés fatales, ces demoiselles mystérieuses qui se drapent d’une aura de sensualité mêlée de danger. Il adorait plus que tout celles versant dans le spiritisme et les sciences occultes. Je lui répétais sans cesse que ce penchant lui causerait des ennuis, il riait en me répondant qu’avec ces femmes, il n’y avait aucun péril, juste du plaisir.
Comme j’aurais aimé qu’il eût raison et moi tort ! Comme j’aurais aimé qu’il ne croise jamais la route de Natalia.